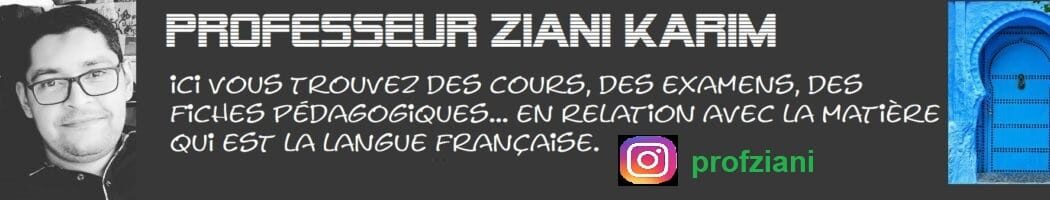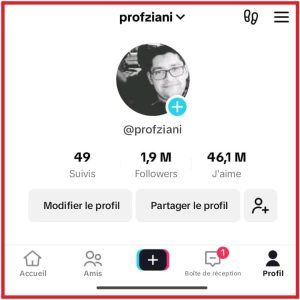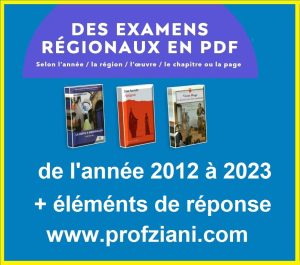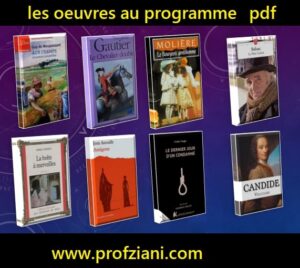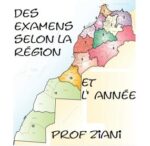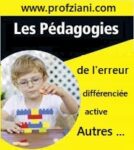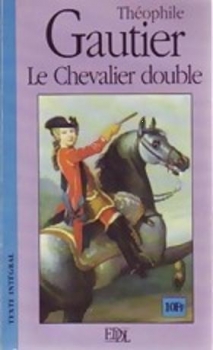
projet pédagogique le chevalier double
projet pédagogique le chevalier double
Tronc commun
Module III
Travail réalisé par : Sous la direction de :
El AAOUAM Hassan M. Abdellah KRIKEZ
KAMILI Abdelkoudous
La progression des Troncs communs : Deuxième semestre
projet pédagogique le chevalier double
Module III : étude d’une nouvelle fantastique
Selon le texte officiel (Orientations pédagogiques pour l’enseignement du français dans le cycle secondaire qualifiant, Mars 2006), nous axerons ce module autour de la nouvelle fantastique « Le chevalier double » de Théophile Gautier. On y travaillera, aussi, sur la poésie.
| Discipline | Activités | Compétences | Contenus |
| lecture | -Observation et analyse de documents relevant du genre étudié -Lecture analytique -Lecture méthodique -Lecture sélective | -Reconnaître un genre littéraire : la nouvelle fantastique -Identifier la structure formelle d’une nouvelle fantastique. -Etudier le fantastique. -Reconnaître les caractéristiques formelles du sonnet. | -les caractéristiques du récit fantastique. -L’intrusion du surnaturel -La rencontre avec le phénomène -L’aventure fantastique -Le dénouement ambigu -La structure narrative de l’œuvre -La progression dramatique la subjectivité du narrateur -La transfiguration du réel -Le rythme du récit : l’ellipse, le retour en arrière, le suspense -Les champs lexicaux, etc. Poésie : le sonnet. |
| langue | -Grammaire de texte -Grammaire de la phrase | -Etudier les éléments assurant la cohérence et la cohésion d’un texte et leurs rôles dans la progression de la narration. | -Les champs lexicaux liés au genre fantastique. -La subordonnée complétive. -L’accord du participe passé. -Quelques moyens de la description : images, hyperboles. -Les modalités appréciatives, les règles de cohérence textuelles, etc. |
| Production de l’oral | Activité orales et TE : -Présentation orale -Jeux de rôle. -Simulations -Discussion -Débats | -Perfectionner les techniques de l’élaboration d’une fiche de lecture. -Prendre des notes à partir d’un document sonore ou écrit. -Participer à la finalisation du projet de classe. -Prendre la parole. -Ecouter activement. -Analyser une image : s’initier aux notions de dénotation et de connotation. Chercher l’information et la traiter en fonction de son projet. | -Participation aux travaux de finalisation du projet. -Présentation d’une fiche de lecture. -Création de supports iconiques (dénotation, connotation). |
| Production de l’écrit | Activité de production écrite : -Production de texte en fonction de consignes -Réécriture de passage | -Produire des énoncés en adéquation avec la situation de communication. -Reformuler des passages (par écrit). -Respecter les éléments de cohérence et de cohésion dans ses écrits. | -Produire de l’écrit dans le cadre d’un projet. -Raconter en changeant les personnages et en variant les points de vue. -Réécrire un récit en supprimant les retours en arrière et en rétablissant la chronologie. -Ecrire de manière de…en utilisant les mêmes procédés pour créer une atmosphère fantastique. -Imaginer un dénouement non ambigu, moins fantastique. Jouer avec les images et les figures de styles. |
Macro compétence visée:
- Etre capable de rédiger un récit fantastique.
Sous-compétences visées :
- Etudier le fantastique
- Reconnaître un genre littéraire : la nouvelle fantastique
- Identifier la structure formelle d’une nouvelle fantastique
- Reformuler des passages (par écrit)
- Prendre des notes à partir d’un document sonore ou écrit.
- Produire des énoncés en adéquation avec la situation de communication
- Prendre la parole
- Ecouter activement
- Analyser une image : s’initier aux notions de dénotation et de connotation
- Chercher l’information et la traiter en fonction de son projet.
- Rédiger le résumé d’une nouvelle.
- Reconnaître les caractéristiques formelles du sonnet.
La progression des séquences
projet pédagogique le chevalier double
La progression du module sera répartie en six séquences. Nous allons en réservées quatre pour l’analyse de cette nouvelle fantastique et deux seront consacrées à l’étude de deux sonnets : Le Dormeur du val d’Arthur RIMBAUD et Mon rêve familier de Paul VERLAINE.
Séquence I : l’arrivée de l’étranger
| Séance | Durée | Activité | Stratégie | Support | Capacités | |
| ½ | 2h | Activités orales | Travaux encadrés | Exposé sur : -le genre fantastique -la biographie de l’auteur Théophile Gautier Repérages des séquences | Initier les élèves : -à la recherche -à la prise de parole Développer l’écoute Découvrir le genre fantastique | |
| 3 | 1h | Lecture | Lecture méthodique | Incipit : « Qui rend ….la fenêtre » pp 77-80 coll. Folio | Identifier la description, l’ordre de la narration : le retour en arrière. Identifier les éléments du fantastique : le suspens | |
| 4 | 1h | Production écrite | Rédaction courte | Résumé de la nouvelle | Elaborer le résumé de la nouvelle à partir du découpage séquentiel | |
Séquence II : la naissance d’Oluf
projet pédagogique le chevalier double
| Séance | Durée | Activité | Stratégie | Support | Capacités |
| 5 | 1h | Lecture | Lecture analytique | Extrait 2 « Edwige est mère…mourante »pp 80-85 | Repérer l’élément perturbateur de l’histoire. Reconnaître l’ellipse narrative |
| 6 | 1h | Langue | Les figures de style | Reconnaître et employer les figures de styles : hyperbole, oxymore, personnification | |
| 7 | 1h | Activités orales | Commentaire + analyse | Image | Initier les élèves à la lecture d’une image Dégager le sens dénoté et le sens connoté |
| 8 | 1h | Production écrite | Rédaction courte | L’ellipse narrative | Restituer une ellipse narrative |
Séquence III : un amour conditionnée
| Séance | Durée | Activité | Stratégie | Support | Capacités | |
| 9 | 1h | Lecture | Lecture sélective | Extrait 3 « Oluf, fils brun…la terreur» pp85-89 | Identifier la pause commentaire Repérer les procédés du registre fantastique | |
| 10 | 1h | Langue | Les champs lexicaux | Dégager les champs lexicaux de la peur, la mort et la fascination | ||
| 11 | 1h | Activités orales | Commentaire + discussion | Description orale : personnages et les objets fantastique d’un film le seigneur des anneaux | prendre la parole s’exprimer librement prises de notes | |
| 12 | 1h | Production écrite | Compte rendre | Compte rendu du film Le seigneur des anneaux | Rédiger un compte rendu à partir d’une prise de note. |
Séquence IV : la résolution de l’énigme
| Séance | Durée | Activité | Stratégie | Support | Capacités | |
| 13 | 1h | Lecture | Lecture méthodique | extrait 4 « Le chemin … la fin» pp 89-97 | Dégager la situation finale et la moralité de la nouvelle. | |
| 14 | 1h | langue | L’accord du participe passé | Maîtriser l’emploi, les fonctions du participe passé et les règles de l’accord | ||
| 15 | 1h | Activités orales | Discussion-Débat | A votre avis faut-il accorder plus d’autonomie aux jeunes ou au contraire les soumettre au contrôle strict des parents | S’exprimer librement Défendre leurs idées Argumenter Prises de notes | |
| 16 | 1h | Production écrite | Rédaction écrite | Rédiger la situation initiale du Chevalier double | Identifier la structure narrative du Chevalier double et restituer sa situation initiale |
La progression des séquences de la poésie :
Les compétences visées :
projet pédagogique le chevalier double
- Identifier les caractéristiques formelles du sonnet
- Savoir analyser un poème
Séquence I :
| Séance | Durée | Activité | Stratégie | Support | Capacités | |
| 1 | 1h | Activités orales | Travaux encadrés | Biographie de Ch. Baudelaire Définition du sonnet | Discuter la biographie de Baudelaire Définir le Sonnet | |
| 2 | 1h | lecture | Lecture linéaire | Le sonnet « recueillement » de Baudelaire | Dégager le sens du poème | |
| 3 | 1h | langue | La versification | Maîtriser les règles de la versification : la rime. | ||
| 4 | 1h | Production écrite | Rédaction | Ecrire un quatrain | Amener les élèves à écrire un quatrain à rime croisée Initiation à l’écriture Poétique |
Séquence II :
| Séance | Durée | Activité | Stratégie | Support | Capacités | |
| 5 | 1h | Activités orales | Travaux encadrés | Biographie de Rimbaud Définition du symbolisme | Discuter la biographie de Baudelaire Définir le Symbolisme | |
| 6 | 1h | lecture | Lecture linéaire | Le sonnet « Le dormeur du val » de Rimbaud | Dégager le sens du poème. | |
| 7/8 | 2h | Production écrite | Compte rendu | Le thème de la guerre | Discuter le thème de la guerre pour rédiger une rédaction sur le sujet |
| Fiche | 1 |
| Module | III la nouvelle fantastique « Le chevalier double » |
| Activités | Orales |
| Durée | 2h |
| Séquence didactique | N° 1 |
| Capacités privilégiées | -Présenter la biographie de T. Gautier. -Définir la nouvelle et la nouvelle fantastique. -Repérer les séquences. |
| Matériels didactiques | La nouvelle Le chevalier double |
| Stratégie adoptée | Travaux encadrés |
Déroulement de la leçon :
projet pédagogique le chevalier double
Au début de la séance les élèves vont exposer (exposés binaires) leurs recherches sur la biographie de T. Gautier.
Pendant cette séance le professeur jouera le rôle d’animateur, il organisera la prise de parole entre les élèves.
Par une série de questions, le professeur aidera les élèves à récapituler.
| Professeur | Apprenant |
| -En quelle année est né T. Gautier ? | 1811 |
| -Dans quel pays ? | En France à Tarbes |
| -Où T. Gautier a suit ses études ? | Au collège de Charlemagne |
| -Quelles sont les principales publications de T. Gautier ? | 1858 : Le Roman de la momie 1863 : Le Capitaine Fracasse 1840 : Le Chevalier double |
| -Quelle est la nomination de T. Gautier ? | Bibliothécaire de la princesse Mathilde |
| -En quelle année T. Gautier est mort ? | 23 octobre 1872 |
Après avoir discuter la biographie de T. Gautier, les élèves passent à la définition de la nouvelle fantastique.
Le professeur va collecter les informations les plus importantes pour écrire la définition sur le tableau.
| professeur | Apprenant | |
| -Qu’est ce qu’une nouvelle d’abord ? | -Une nouvelle est un récit de fiction court, en prose, qui peut être publié aussi bien dans les journaux qu’en recueil. Ce genre littéraire apparu à la fin du Moyen Âge, était alors proche du roman. | |
| -Qu’est ce que la nouvelle fantastique ? | -La nouvelle fantastique est un genre littéraire fondé sur la fiction, racontant l’intrusion du surnaturel dans un cadre réaliste, autrement dit l’apparition de faits inexpliqués et théoriquement inexplicables dans un contexte connu du lecteur. | |
| -Quelles sont les caractéristiques du fantastique chez T. Gautier ? | -Le fantastique de Gautier se caractérise par « l’intrusion brutale du mystère dans la vie « réelle » c’est-à-dire que le fantastique pour Gautier doit se passer dans un univers quotidien pour ne pas détourner le lecteur. |
Après la biographie, le professeur passe au repérage des séquences.
Le professeur précisera les extraits à étudier pour ce module en déterminant les pages selon chaque édition.
N. B : le départage séquentiel suppose une lecture préalable de la nouvelle.
Le professeur précisera le texte et demandera aux élèves d’extraire l’idée générale de chaque séquence, les réponses seront organisées sous forme de tableau :
| Séquence | Numéro de page (collection Folio) | Nom de la séquence |
| Extrait 1 | De la page 77à la page 80 | L’arrivée de l’étranger |
| Extrait 2 | De la page 80à la page 85 | La naissance d’Oluf |
| Extrait 3 | De la page 85à la page 89 | Un amour inconditionné |
| Extrait 4 | De la page 92à la page 97 | La résolution de l’énigme |
Prolongement possible : Cette séance de repérage sera utilisée dans l’activité de production écrite pour élaborer le résumé de la nouvelle.
projet pédagogique le chevalier double
| Fiche | 2 |
| Module | III la nouvelle fantastique « Le chevalier double » |
| Activités | Lecture |
| Durée | 1h |
| Séquence didactique | N° 1 |
| Capacité privilégiée | -Identifier la description et l’ordre de la narration : retour en arrière et les éléments du fantastique |
| Matériels didactiques | La nouvelle Le chevalier double |
| Stratégie adoptée | Lecture méthodique |
| Déroulement de la leçon : |
| Mise en situation | -Comment appelle -t-on le premier passage d’une œuvre ? -d’où est-il extrait ? -Qui a écrit cette nouvelle ? | L’incipit La nouvelle Le chevalier du double Théophile Gautier Cet extrait est l’incipit de la nouvelle fantastique de T. Gautier écrit en 1852 |
| Identification du passage | -Quel est le genre de l’œuvre ? -Quel est le type du passage ? | La nouvelle fantastique Narratif, descriptif |
| Les hypothèses de lecture | Qu’est ce qu’on peut étudier dans ce passage ? | La description ? La narration ? Les éléments du fantastique ? |
| Les axes de lecture | Axe1 : -Quels sont les principaux personnages de cet extrait ? – Relevez leur portrait physique et moral ? -Par quel temps l’étranger est-il venu au château ? -Comment peut-on expliqué ce mauvais temps ? | Edwige, l’étranger -Le mauvais temps – Son arrivée est de mauvais augures |
| Axe 2 : -Est-ce que le narrateur suit un ordre normal dans sa narration ? Justifiez | -Non, le narrateur recours au flash back, au retour en arrière. | |
| Axe 3 : -Pourquoi le narrateur commence par des questions ? -Comment trouvez-vous le portrait opposé de l’étranger ? -Est-ce que le narrateur nous a révélé l’identité de l’étranger ? | -Pour créer du suspens Ambigu, le narrateur a présenté l’étranger avec une personnalité ambiguë Non | |
| Synthèse | Donnez la synthèse de ce passage ? | L’incipit nous présenté la situation initiale par le recours au flash, il nous présenté les personnages avec une certaine ambiguïté pour introduire le fantastique et le surnaturel. |
Caractéristiques des deux personnages :
| Portrait physique | Portrait moral | |
| Edwige | Blonde, petites mains, diaphanes et amaigries, flanc, immobile, comme la statue d’albâtre | Triste, assise à l’écart, morne, désespérée |
| L’étranger | Beau comme un ange, sourire doux, teint bruni regard doux | Glaçant, effrayant, gracieux scélérate, perfide |
| Fiche | 3 |
| Module | III la nouvelle fantastique « Le chevalier double » |
| Activités | Production écrite |
| Durée | 1h |
| Séquence didactique | N° 1 |
| Capacité privilégiée | –Elaborer le résumé de la nouvelle à partir du découpage séquentiel |
| Matériels didactiques | La nouvelle Le chevalier double |
| Stratégie adoptée | Le résumé |
Déroulement de la leçon :
projet pédagogique le chevalier double
| Etapes | Activités proposées par le professeur | Tâches à réaliser par l’élève |
| Rappel | Le professeur fait un rappel de la séance de l’activité orale. 1-De combien de séquence se compose cette nouvelle ? 2-Quel est le nom de la première séquence ? -3 Comment est cet étranger ? 4-Quel effet a eu sur la comtesse Edwige ? 5-Pourquoi Edwige est devenue triste après le départ de l’étranger ? | 1-De 4 séquences 2-L’arrivé de l’étranger 3-Beau 4-La séduction 5-Elle cachait un secret |
| Phase orale | Quel est le nom de la deuxième séquence ? – Comment est-il ? est ce qu’il est un enfant normal ? -Quel effet a eu cette dualité sur ses relations ? -Qu’est ce qui arrive aux femmes qui s’approchent d’Oluf ? -Comment s’appelle la femme qui a fait l’exception pour Oluf ? -Quel sentiment existe entre Oluf et Brenda ? -Quel est le nom de la 3ème séquence ? -Est-ce que Brenda a accepté Oluf avec sa double personnalité ? -Quelle était sa condition ? -Quel est le nom de la dernière séquence ? -Que décide Oluf de faire ? -Quel est le résultat du combat ? -Que symbolise cette victoire ? | La naissance d’Oluf -Non, il avait une double personnalité -Des effets positifs et négatifs surtout avec les femmes -Elles deviennent malheureuses à cause de son double caractère. -Brenda -Un sentiment d’amour |
| Phase écrite | A partir de ces données vous allez élaborer un résumé général de la nouvelle. -Qu’est ce qu’un résumé ? Ce qu’il ne faut pas dire dans un résumé ? Le professeur choisit la meilleur des productions pour la noter sur le tableau ou rédiger ensemble. | -Réduire en respectant l’ordre des idées. -L’auteur déclare que…… |
| Fiche | 4 |
| Module | III la nouvelle fantastique « Le chevalier double » |
| Activités | Lecture |
| Durée | 1h |
| Séquence didactique | N° 4 |
| Capacités privilégiées | -Identifier la situation finale -Ressortir la moralité de la nouvelle |
| Matériels didactiques | La nouvelle Le chevalier double |
| Stratégie adoptée | Lecture méthodique |
Déroulement de la leçon :
projet pédagogique le chevalier double
| Etape | Activités proposées par le professeur | Tâches à réaliser par élève | |
| Mise en situation Lecture magistrale | -Quels sont les personnages de ce passage ? -Quel est l’événement qui précède ce passage ? -Que se passe t-il lors de cette rencontre ? -Quelle est cette condition ? | -Oluf, Les deux chiens, et le chevalier rouge -La rencontre avec Brenda. -Brenda a imposé une condition à Oluf. -Combattre sa double personnalité. En rentrant de sa rencontre amoureuse avec Brenda Oluf croise dans son chemin sa double personnalité. | |
| Identification du passage | -Quel est le genre de l’œuvre ? -Quel est le type du passage ? | Une nouvelle fantastique Texte narratif | |
| Les axes de lecture | Axe1 -Que rencontre Oluf vers le chemin du retour ? -Quelle est la cause de leur combat ? -Est ce qu’Oluf a su au début que le chevalier était son double ? | -Un chevalier Le chevalier n’a pas voulu céder le chemin à Oluf Non Le combat est déclenché à cause de l’obstination des deux chevaliers. Oluf ignorait au début l’identité du chevalier. Féroce et sanglant Combattre son double, sentir les coups donnés à son double La victoire d’Oluf Le spectre jeta un grand cri et disparu, la spirale de corbeaux remonta dans le ciel, la nuit était claire et bleue. Heureuse de sa victoire. Oui, il n’avait pas l’étoile rouge, le jais de ses yeux s’était changé en azur. En combattant son double, l’étoile rouge disparaît et Oluf devient de plus en plus stable et serein. -Le triomphe du bien sur le mal Il faut se méfier des apparences, il faut toujours lutter contre le mal | |
| Axe 2 -Comment était le combat entre les deux chevaliers ? -Quelle est la particularité de ce combat ? -Quel est le résultat du combat ? -Relevez du texte les indices qui montrent que le chevalier à l’étoile rouge est vaincu ? -Quelle était la réaction de Brenda ? -Est ce qu’Oluf a changé après sa victoire ? -Que symbolise la victoire d’Oluf ? -Quelle moralité peut- on tirer de cette nouvelle ? | |||
| Synthèse | Donnez la synthèse de ce passage ? | L’amour qu’éprouvé Oluf pour Brenda le motivait pour combattre sa double personnalité ce qui l’a rendu heureux et paisible, cette victoire a fait régner le calme et le bonheur dans le Palais des Lodborg. |
| Fiche | 5 |
| Module | III la nouvelle fantastique « Le chevalier double » |
| Activités | Langue |
| Durée | 1h |
| Séquence didactique | N° 4 |
| Capacité privilégiée | – Maîtriser l’emploi, les fonctions du participe passé et les règles de l’accord. |
| Matériels didactiques | La nouvelle Le chevalier double |
Déroulement de la leçon :
| Etapes | Activités proposées par le professeur | Taches à réaliser par l’élève |
| I- Observation | Observez le corpus suivant: P1-Elle avait éprouvé un grand froid P2- Les deux chevaliers étaient blessés P3-La décision que j’ai prise était la bonne P4-Elles se sont résolues à rentrer à pied P5-Les écailles imbriquées des armures Lecture magistrale | Lecture individuelle |
| II-Conceptualisation | – Pourquoi dans P1 le participe n’a pas été accordé et dans P2 il y a l’accord ? – Qu’est ce que vous remarquez dans P3? – Pourquoi a votre avis? – Comment appelle-t on le genre de verbe utilisé dans P4? Avec quel type d’auxiliaire les verbes pronominaux se conjuguent ils? Dans P4 déterminez la valeur du participe passé « imbriquées » | Dans P1, le participe passé est conjugué avec l’auxiliaire « avoir » donc pas d’accord alors que dans P2 il est conjugué avec l’auxiliaire « être » il y a l’accord en genre en nombre. Le participe passé a pris l’accord alors qu’il est conjugué avec l’auxiliaire « avoir ». Parce que le complément d’objet direct est placé avant le verbe dans ce cas il s’accorde en genre en nombre. C’est un verbe pronominal Avec l’auxiliaire « être ». Le participe passé a la valeur d’un adjectif s’accordant en genre en nombre avec le nom auquel il se rapporte. |
| III- Appropriation réemploi | Construisez des phrases dans lesquelles le participe passe est employé soit avec l’auxiliaire être ou avoir et vous dites s’il y a accord ou non et pourquoi? | Propositions des élèves et affinement du professeur. |
| IV- Exercices D’application | Accordez correctement les participes passés des verbes suivants: 1- Il s’est (réveillé) très tôt le matin. 2- Ils ont (vu) le film qu’ils adorent. 3- La nouvelle que j’ai (entendu) m’a réchauffé le cœur. 4- Ses yeux avaient une couleur (nuancé). 5- Des phénomènes étrangers s’étaient (produit) dans la nuit. 6- Elle et moi, nous sommes (allé) aider Siham à déménager. | Correction collective sur le tableau avec la consolidation des concepts. |
| V- Traces Ecrites | En général, le participe passé ne s’accorde jamais avec l’auxiliaire « avoir ». Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il dépend dans les cas suivants:- L’auxiliaire « être » – Les verbes pronominaux – Lorsque le complément d’objet direct est placé avant le verbe. | Lecture de la récapitulatif. |
| Fiche | 6 |
| Module | III la nouvelle fantastique « Le chevalier double » |
| Activités | activités orales |
| Durée | 1h |
| Séquence didactique | N° 4 |
| Capacité privilégiée | Exprimer son point de vue |
| Matériels didactiques | La nouvelle Le chevalier double |
| Stratégie adoptée | Le débat |
Déroulement de la leçon :
| Etapes | Activités proposées par le professeur | Taches à réaliser par l’élève |
| I- Présentation du sujet | Sujet: A votre faut-il accorder aux jeunes la liberté totale ou au contraire les soumettre au contrôle strict de leurs parents ? Consigne: exprimez à titre personnel votre point de vue sur cette question de l’autonomie des jeunes. Lecture magistrale | Lecture individuelle |
| II-Explication du sujet | De quel thème s’agit-il? Repérez les mots clés? | C’est le thème de l’autonomie des jeunes Jeunes, liberté totale, contrôle parents, autonomie. |
| III- Discussion | – le sujet suppose combien de positions ? Qui sont parmi vous ceux qui sont pour la liberté totale des jeunes et pourquoi ? Et qui sont ceux qui sont contre cette liberté totale et pourquoi ? Et pour les partisans d’une liberté mitigée quelles sont vos raisons ? | Le sujet suppose trois positions : Pour la liberté total des jeunes Contre la liberté totale des jeunes Pour une liberté contrôlée Les partisans de cette position donnent les raisons suivantes : Apprendre la responsabilité Devenir adulte Ceux qui adopteront cette position c’est pour les raisons suivantes : Risque de commettre de graves erreurs Les jeunes ont besoins de l’expérience des parents Les parents seront des amis Confiance mutuelle entre les jeunes et les parents. |
| IV- synthèse : traces écrites | Faites une petite synthèse des idées discutées ? | La meilleure synthèse proposée par les élèves sera marquée sur le tableau. |
| Fiche | 7 |
| Module | III la nouvelle fantastique « Le chevalier double » |
| Activités | production écrite |
| Durée | 1h |
| Séquence didactique | N° 4 |
| Capacité privilégiée | Rédiger la situation initiale du Chevalier double |
| Matériels didactiques | La nouvelle Le chevalier double |
Déroulement de la leçon :
projet pédagogique le chevalier double
| Etape | Activité proposée par professeur | Tâches à réaliser par élève | |
| Phase orale élaboration d’un plan Phase écrite | -Quelles sont les étapes du schéma narratif ? -Que trouve t-on généralement dans la situation initiale d’un récit ? -Est- ce que le début de la nouvelle Le chevalier double correspond à l’étape de la situation initiale ? 1/précisez le lieu de l’action et décrivez- le ? 2/ précisez le temps 3/ présentation des personnages ? Consigne : Utilisez les temps du récit : Passe simple, imparfait et utilisez des figures de styles pour créer des images. Ecouter les différentes productions pour choisir la meilleure, la corriger et la noter sur le tableau ou bien la rédiger ensemble. | –La situation initiale/l’événement perturbateur/ les péripéties/l’événement équilibrant/la situation finale -Le temps, le lieu, présentation des personnages : portrait physique et morale+ relations entre eux… – L’équilibre règne dans le début d’un récit. -Non, il correspond à l’action, ensuite, le narrateur fait un retour en arrière pour raconter l’événement perturbateur (l’arrivée de l’étranger qui trouble le cœur et l’esprit d’Edwige avec ses poèmes étranges) .-pays (Norvège) : pays nordique, froid, neige … -Habitation : un château : médiéval, vieux, vieux château, somptueusement meublé, serviteurs, servantes. – il est- imprécis dans la nouvelle, mais on peut déduire que c’est au moyen âge que se passent les événements. autrefois, il y a très longtemps, (il était au moyen) -Edwige : description physique et morale Leur classe sociale, leur vie heureuse, mais qui manque d’enfants. |
| Fiche | 16 |
| Module | La poésie « le sonnet » |
| Activités | Orales |
| Durée | 1h |
| Séquence didactique | N° 6 |
| Capacités privilégiées | – Présenter la biographie de Ch. Baudelaire. – Définir le sonnet. |
| Matériels didactiques | Poésie de Baudelaire |
Déroulement de la leçon :
| Etape | Activités proposées (professeur) | Tâches à réaliser (élève) |
| Mise en situation Exposé binaire | Le professeur distribue la photo de Baudelaire -C’est à qui cette photo, ce portrait ? -Comment l’avez-vous trouvé ? A partir de ce portrait essayez de donner vos impressions sur lui ? Après l’exposition de leurs travaux le professeur pose des questions pour remplir le tableau. Les réponses de ses questions seront organisées dans le tableau ci-dessous. | -Charles Baudelaire -triste -Un caractère sévère et triste, aspect terne |
| Son nom | Date et lieu de naissance | Une famille douloureuse | Elevé peu discipliné | Une vie de Bohémien | Ses productions | Sa mort |
| Charles Baudelaire | Né à paris le 9 avril 1821 | sa famille : son père à plus de 60 ans, un homme cultivé qui favorisera l’éveil de sa sensibilité pour les arts plastiques. Après sa mort Charles se sentait seul, surtout que sa mère s’est rapidement remariée avec un commandant. Révolté par ce mariage Baudelaire est mis en pension à Lyon. | Au lycée : après un triste séjour à Lyon de 1832à 1836, Charles au lycée à paris 1836à 1939. Passionné de poésie, il lit Victor Hugo, Rêve plus qu’il ne travaille, compose des vers et fut renvoyé à plusieurs reprises chez le proviseur qui fini par le renvoyer du lycée. | Un voyage : pou l’arracher de la vie désordonnée qu’il menait avec des jeunes provinciaux, sa famille décide de lui faire effectuer un long voyage en Inde. Le voyage enrichit sa sensibilité, éveille la poésie de la mer, du soleil. Héritier de son père, Baudelaire se lance dans la vie de bohême, il fréquente les restaurants, les musés les ateliers ; ce que pousse sa famille à le priver de sa fortune et désormais vivra misérablement | Les fleurs du mal en 1859 Le spleen de Paris en 1862 | A cause de l’alcool, il s’attaque d’une aphasie et meurt en août 1867 |
Après avoir présenté la biographie de Baudelaire, les élèves exposent les recherches faites sur le sonnet.
projet pédagogique le chevalier double
Après l’exposition, le professeur écrit une note sur le tableau.
Le sonnet est un poème à forme fixe composé de 14 vers répartis en 2 quatrains suivis d’un sizain. Importé d’Italie par Marot au 16ème siècle et remit en honneur au 19 ème siècle par Baudelaire qui le choisit souvent sans respecter les règles.
| Fiche | 16 |
| Module | La poésie « le sonnet » |
| Activités | Lecture |
| Durée | 1h |
| Séquence didactique | N° 6 |
| Capacité privilégiée | -Dégager le sens du poème |
| Matériels didactiques | Le poème « Recueillement » de Baudelaire |
| Stratégie adoptée | Lecture linéaire |
Déroulement de la leçon :
| Etape | Activité proposée par professeur | Tâches à réaliser par élève |
| Mise en situation | -Quel est le type de ce texte ? -Qui a écrit ce poème ? -Quel est le genre de ce poème ? justifier? -Quel est le titre de ce sonnet ? | -Un poème Charles Baudelaire Le sonnet, 14 vers Recueillement Ce poème est un sonnet de Baudelaire écrit en1861 |
| Lecture vocale 1ère strophe 2ème strophe 3ème strophe 4ème strophe Synthèse | Que signifie ce titre? -Que fait le poète au début du poème ? -Quel sentiment ressens t-il ? -De quelle douleur s’agit-il ? -Il s’adresse à qui ? -Comment qualifie t-il cette douleur ? -Il s’adresse à qui particulièrement quand il dit « sois tranquille » ? -Que demande le poète à sa douleur ? -De quel moment de la journée parle t-il ? -Est-ce que le poète aime le soir ? Quel mot l’indique ? -Que représente le soir pour le poète ? -Que représente le soir pour les autres ? -Que signifie le fait de dire aux « uns » et aux « autres » ? – Que signifies «-tu » ? -Dans quel milieu vit le poète ? -Comment se manifeste la présence du poète dans le poète ? – récapitulons, quelle est idée générale de la strophe ? -De qui parle t-il dans cette deuxième strophe ? -Que signifie « multitude » ? -Que font les autres ? -De quoi parle le poète dans le deuxième vers ? -Comment décrit –il le plaisir ? -A qui le compare t-il ? -Les mots « fouet, bourreau » font partie de quel champ lexical ? -Que ressent le poète par rapport à ces gens soumis au plaisir ? -Est-ce qu’il est impliqué avec eux ? -Comment le poète considère t-il sa douleur en disant « donne –moi la main » ? -Récapitulez ? -A qui se réfère le « eux » ? -Que signifie « défuntes années » ? -De quoi se souviens t-il ? -A quoi compare t-il ses souvenirs ? -Que ressens t-il par rapport à ses souvenirs ? -Comment est-il ce regret ? pourquoi ? Récapitulez ? -Que signifie le mot « Moribond » ? -Que signifie l’expression « soleil moribond » ? -Comment appelle t-on ce procédé ? -Quand il dit « soleil moribond » il le compare à quel état ? -Où se couche le soleil du poète ? -Pourquoi ? -Comment considère t-il sa douleur ? -Comment appelle t-on la poésie où on exprime ses sentiments ? -Que représente le dernier vers ? Pour récapitulez ? Synthétisez le poème ? | ça vient du verbe recueillir= s’isoler du monde pour se concentre sur sa vie spirituelle surtout à l’approche de la mort. -il interpelle quelqu’un. -la douleur -l’approchement de la mort -à sa douleur Comme une personne, il personnifie sa douleur. -il s’adresse à sa douleur comme s’il s’adresse à un enfant -d’être tranquille, de se calmer, de s’apaiser. -Le soir -Oui, « réclamait » il le revendique. -Le calme, la sérénité -Le souci -Que le poète s’isole des autres -Le poète tutoie sa douleur, il entretient avec elle une relation amicale -La ville, le milieu urbain. -Le pronom possessif « Ma ». -Le poète sent l’approchement de la mort, il se recueille avec sa douleur en la personnifiant et en entretenant avec elle une relation amicale. -Des mortels -La foule les gens les autres dans le poème. -La fête -Du plaisir. -Comme un bourreau, – A une personne sans pitié. -Le champ lexical de l’esclavage. -Du remord -Non, il essaye toujours de s’échapper avec sa douleur. -comme une personne qui va le sauver de la foule soumise au plaisir. Par le champ lexical de l’esclavage, le poète décrit la situation des autres par rapport au plaisir, quant à lui, il essaye toujours de s’échapper avec sa douleur. -Les autres -Ses souvenirs -De ses années quand il était lui aussi soumis au plaisir. -Aux robes surannées -Du regret -Souriant, parce qu’il est parvenu à se débarrasser de son attachement au plaisir. Le poète se souvient avec regret des années quand il était lui aussi soumis au plaisir de la vie terrestre et urbaine. -Mourant -Soleil couchant -La métaphore -A son état parce que lui aussi est mourant. -A l’orient – cette inversion de l’ordre universel montre la tentative de Baudelaire d’échapper à la contrainte de sa condition humaine (la mort). -Sa chère -Poésie lyrique. -La chute du poème. Dans cette dernière strophe, le poète sent la mort douce c’est la chute du poème Ce sonnet lyrique décrit l’état d’âme de Baudelaire en attendant la mort, un Baudelaire qui se recueille avec sa douleur personnifiée pour la rendre plus paisible. Il accueille sa mort avec sérénité et patience tout en s’éloignant de sa vie urbaine. |
| Fiche | 17 |
| Module | La poésie « le sonnet » |
| Activités | Langue |
| Durée | 1h |
| Séquence didactique | N° 6 |
| Capacité privilégiée | – Reconnaître et identifier la rime |
| Matériels didactiques | Le poème « Recueillement » de Baudelaire |
Déroulement de la leçon :
| Etapes | Activités proposées par le professeur | Taches à réaliser par l’élève |
| I- Observation | Observez le quatrain suivant de Charles Baudelaire: V1- Sois sage; ô ma douleur, et tiens-toi tranquille V2- Tu réclamais le soir, il descend le voici V3- Une atmosphère obscure enveloppe la ville V4- Aux uns portant la paix, aux autres le souci Lecture magistrale | Lecture individuelle |
| II-Conceptualisation | Quel est le point de ressemblance entre les vers 1 et 3, et entre les vers 2 et 4 ? Comment appelle t- on ce phénomène en poésie ? Comment ces rimes sont- elles disposées ? Quels sont les autres types de disposition que vous connaissez ? Comment s’appelle la rime où il y a deux phonèmes communs ? Et la rime ayant un seul phonème commun ? Et le cas où la rime à trois phonèmes communs ? | Chacun de ces deux vers se terminent par le même son : v1et v3= [il], v2et v4= [si] On l’appelle la rime. Elles sont disposées en forme de ABAB, ce sont des rimes croisées. Les rimes plates : AABB et les rimes embrassées ABBA. C’est la rime suffisante. C’est la rime pauvre. C’est la rime riche. |
| III- Appropriation réemploi | Dans le 2ème quatrain du poème de Recueillement, déterminez la disposition des rimes et vous dites la qualité de la rime si elle est pauvre, suffisante ou riche ? | La réalisation de cette tache se fera avec l’affinement et le redressement du professeur. |
| IV- Exercices D’application | A partir du quatrain suivant d’Arthur Rimbaud, vous précisez la disposition des rimes tout en signalant s’il s’agit d’une rime pauvre suffisante ou riche. -C’est un trou de verdure où chante une rivière -Accrochant follement aux herbes des haillons -D’argent, où le soleil, de la montagne fière -Luit; c’est u un petit val qui mousse de rayons. | Correction collective sur le tableau avec la consolidation des concepts. |
| V– Traces Ecrites | La rime est la répétition da la même sonorité à la fin d’un vers. Les rimes peuvent être disposées de trois manières différentes: Rimes croisées ABAB. Rimes plates ou suivies AABB. Rimes embrassées ABBA. La rime peut être pauvre avec un seul phonème commun ou suffisante avec deux phonèmes communs ou bien riche avec trois phonèmes communs. | Lecture du récapitulatif. |
| Fiche | 18 |
| Module | La poésie « le sonnet » |
| Activités | Production écrite |
| Durée | 1h |
| Séquence didactique | N° 6 |
| Capacité privilégiée | – Ecrire un quatrain avec une rime croisée |
| Contenu | – Ecrire un quatrain |
Déroulement de la leçon :
projet pédagogique le chevalier double
| Etape | Activité proposée par le professeur | Tâches à réaliser par l’élève |
| Rappel Phase orale Sujet Phase écrite | -Quels sont les types de rimes ? -Comment appelle t-on une strophe composée de 4 vers ? -Donnez d’autres types de strophes ? -Quels sont les principaux sujets exploités dans la poésie ? -Vous allez choisir un sujet quelconque pour écrire un petit quatrain à rime croisée. Pour aider les élèves le professeur précisera la rime. La première rime est « ion » La deuxième rime est « our ». Ecouter les différentes productions pour choisir la meilleure, la corriger et la noter sur le tableau ou bien la rédiger ensemble. | rimes plates (AABB) rimes croisées (ABAB) rimes embrassées (ABBA) quatrain : 4vers distique : 2vers, tercet : 3 vers, sizain : 6 vers septain : 7vers, dizain : 10 la description de l’état d’âme, la nature |
DOCUMENTATIONS & NOTES UTILES
AU DEROULEMENT DE CE MODULE
Biographie envisagée sur Gautier :
Né à Tarbes, Théophile Gautier fait ses études à Paris au collège Charlemagne, où il rencontre Gérard de Nerval. Celui-ci, en 1829, le présente à Hugo dont Théophile, vêtu de fameux gilet rouge, va prendre le parti lors de la bataille d’Hernani (1829) et qu’il admirera toute sa vie. Après avoir été tenté par la peinture, Gautier publie ses premières Poésies en 1830, suivies de divers autres œuvres poétiques et romanesques, il fait paraitre en 1835 Mademoiselle de Maupin dont la célèbre Préface annonce la doctrine de l’art pour l’art. Gautier voyage et écris beaucoup : récits de voyage, feuilletons, livrets de ballet, articles. Dans Emaux et Camées (recueil de poèmes courts paru en 1852), il célèbre le culte de la forme et de la beauté. Des nombreuses publications ultérieures de Gautier, le roman de la momie 1858 ; Le Capitaine Fracasse 1863 ; Malade du cœur et très affecté par la défaite de 1870 Gautier meurt en 1872.
Définition du fantastique:
Le fantastique est une forme artistique qui faisait intervenir les éléments surnaturels dans le monde quotidien. Pour Tzvetan Todorov (Initiation à la littérature fantastique 1970) « le fantastique, c’est l’hésitation éprouvée par un être qui ne connait que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel ».
Les caractéristiques du fantastique:
-Le cadre du récit fantastique est souvent inquiétant parfois exotique, mais il peut être parfois très ordinaire ;
-Les personnages peuvent se trouver affaiblit ;
-Les événements relèvent de l’ordre magique et appartiennent à un monde inversé ;
-Les mots et les objets s’animent ;
-Les êtres et la matière sont doués de pouvoirs magiques, à la suite de pactes passés avec le diable ;
-Les récits fantastiques se terminent généralement par un événement sinistre qui provoque la mort, la damnation ou la disparition du héros ;
-L’écriture fantastique met en évidence l’oscillation permanente être le surnaturel et le réel ;
-L’incertitude est renforcée par la narration ;
-Le narrateur, qui parle à la première personne, est la première victime du doute qu’il communique à son lecteur ;
-Les nombreuses figures de style (personnification, images…) traduisent la superposition de deux univers : le naturel et le surnaturel, et ajoutent à l’hésitation.
Le fantastique de Gautier :
Il se caractérise par « une intrusion brutale du mystère dans la vie réelle » c’est-à-dire que le fantastique pour Gautier doit se passer dans un univers quotidien pour ne pas dérouter le lecteur. Dans cette nouvelle, la notion de la peur ne fait pas partie des composantes du fantastique. Oluf brave tous les dangers avec courage.
Le résumé envisagé:
L’étranger demanda l’hospitalité aux Lodbrog pour s’abriter à la tempête. Cette dernière dura longtemps. Ainsi et pour passer le temps, le bohémien chantait des poésies étranges qui charmaient Edwige.
Neuf mois après le départ du maitre chanteur, la comtesse enfante d’un bébé dont le regard noir ressemblait à celui du bohémien. Aussi la mère fut elle triste et commence à avoir de la peine chose que son mari ne remarquait pas, car il était heureux d’avoir assuré la continuité à son nom.
Comme il en est de coutume, Le mire tira l’horoscope au nouveau né. Il fut surpris de découvrir qu’il était né sous l’influence d’une étoile double : une verte et une rouge. Donc l’enfant serait ou bien heureux, ou bien malheureux ou les deux à la fois.
projet pédagogique le chevalier double
Le dormeur du val de A. Rimbaud
C’est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où, le soleil de la montagne fière,
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
A. Rimbaud, Poésies.
Biographie envisagée sur A. Rimbaud
Arthur Rimbaud (Jean Nicolas Arthur Rimbaud) est un poète français, né le 20 octobre 1854 à Charleville, dans les Ardennes, et mort le 10 novembre 1891 à l’hôpital de la Conception à Marseille.
Lycéen brillant et poète précoce, Arthur Rimbaud excelle dans les compositions latines, parmi lesquelles on trouve ses plus anciennes productions en vers connues. Sous l’influence des romantiques et des parnassiens, ses premiers vers français connus datent de la fin de l’année 1869 (Les Étrennes des orphelins et Invocation à Vénus, plagiat d’une traduction de Lucrèce par Sully Prudhomme). Bientôt soutenu par son nouveau professeur Georges Izambard en classe de rhétorique, il écrit à quinze ans et demi ses premiers poèmes importants qu’il envoie à Théodore de Banville